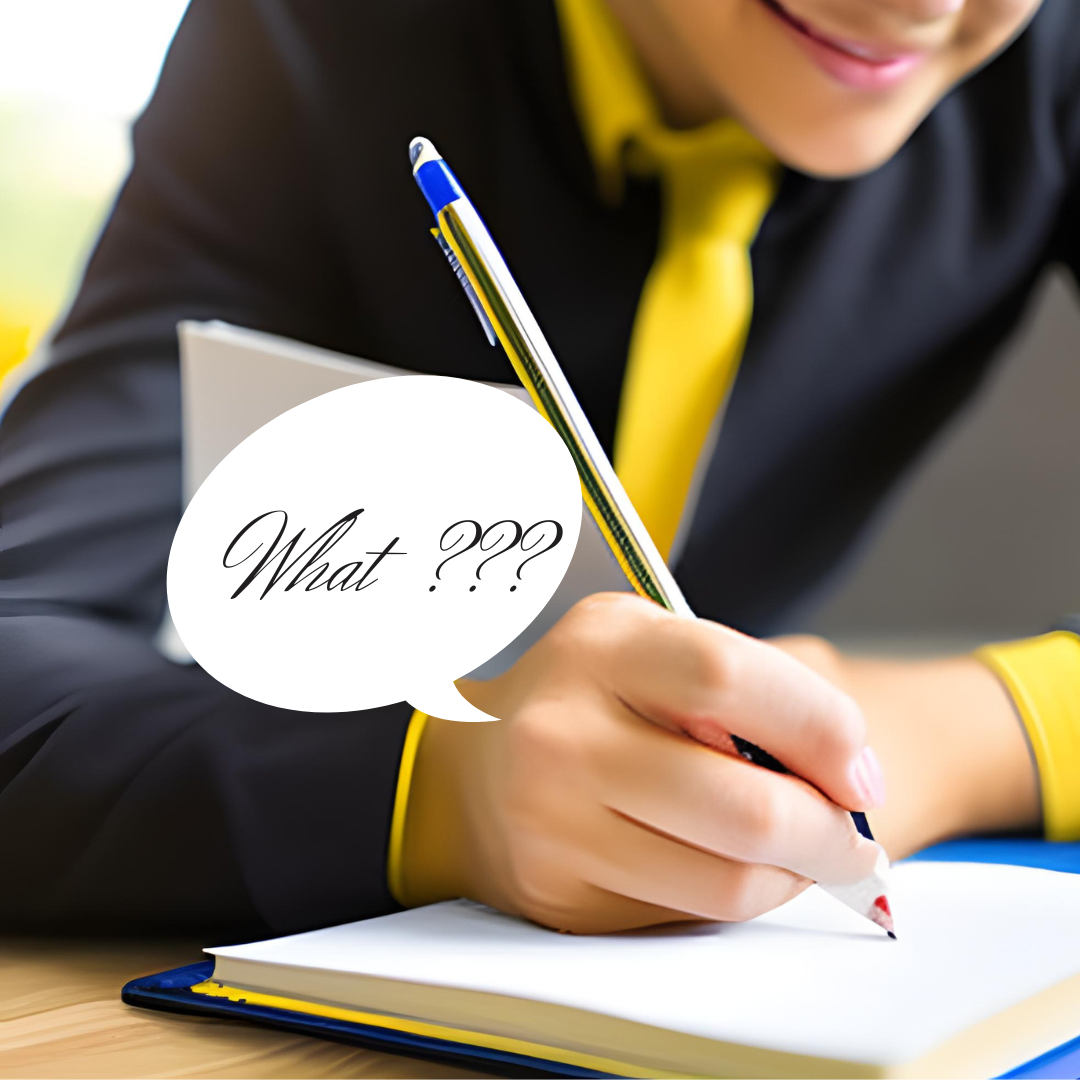Avez-vous l’impression que tous vos efforts pour décrocher un entretien ont servi à rien ?
En avez-vous marre de passer des heures à peaufiner votre CV sur mesure pour rien ? marre de voir vos entretiens qui n’aboutissent pas ?
Vous n’en pouvez plus de recevoir des mails du genre “Merci de votre candidature, mais après mure reflexion…? »
Vous sentez-vous dévalorisé, frustré et impuissant ?
Votre motivation est au plus bas et vous vous demandez si vous ne feriez pas mieux d’arrêter ?
Je vous comprends, surtout si comme moi vous n’êtes pas préparé au processus de recherche d’emploi et que vous n’avez pas du tout idée de comment ça se passe.
Etes-vous préparé à affronter le marché du travail ?
La recherche d’un emploi est une véritable montagne russe émotionnelle.
La plupart des demandeurs d’emploi y compris les doctorants, mettent à jour leur CV, parcourent les sites d’offres d’emploi et réfléchissent à ce qu’ils vont dire en entretien, mais peu d’entre eux se préparent au voyage émotionnel qui les attend pendant la recherche d’emploi.
Pourquoi est-il important de se préparer à ce voyage émotionnel ?
Parcequ’il est très facile pour un recruteur de lire la défaite, la frustration et l’anxiété chez un candidat lors d’un entretien d’embauche. Malheureusement, de nombreux recruteurs les interprètent comme des signaux d’alarme.
Si vous n’avez pas encore réfléchi à la manière dont vous vous préparerez à l’aspect émotionnel du processus d’embauche, c’est l’occasion ou jamais !
Une étude a montré que 51% des demandeurs d’emploi hautement qualifiés ont du mal à faire face aux rejets répétés et que le fait d’être rejeté affecte négativement l’estime de soi.
La bonne nouvelle c’est que cette même étude a révélé que la façon de réagir face au rejet, améliore le sentiment par rapport au rejet.
Si par exemple les candidats voient le rejet comme un défi plutôt qu’un échec, alors ils sont plus susceptibles de trouver un emploi plus tard.
Le rejet fait partie de la vie et aussi de la recherche d’emploi.
La clé est de ne pas laisser la frustration prendre le dessus sur votre objectif de carrière et de transformer chaque défi comme une opportunité.
Voici les 5 stratégies pour rester motivé malgré les multiples rejets.
Accueillez vos émotions au lieu de les ignorer
La pire façon de faire face au rejet est de le nier. Plus vous vous trompez en affirmant que cela n’a pas d’importance, plus il sera difficile de surmonter la douleur et la déception. Vous avez été laissé tomber.
Si vous les avez réprimées, vous remarquerez peut-être qu’elles se manifestent sous d’autres formes:
- troubles du sommeil,
- problèmes digestifs
- maux de tête,
- irritabilité accrue ou disputes
- troubles de la concentration ou de la mémoire.

Identifiez la pensée qui déclenche ce que vous ressentez suite à un rejet
Beaucoup d’entre nous traversons la vie en supposant que ce que nous pensons et ressentons est « vrai ». Quand vraiment ce que nous pensons et ressentons n’est qu’une des interprétations possibles.
Imaginez une statue de cheval. Si vous êtes debout en train de regarder la tête et que quelqu’un vous dit qu’il y a une queue, vous pourriez penser qu’il se trompe. La vérité est qu’ils voient simplement les choses sous un angle différent. C’est pareil pour toute situation que vous vivez.
Rappelez-vous que le rejet n’est pas quelque chose qui vous arrive et qui vous fait vous sentir mal. Mais plutôt la façon dont vous choisissez d’interpréter le rejet.
Chaque fois que vous vous sentez rejeté, c’est vous qui en êtes la cause par ce que vous pensez.
Réfléchissez à la pensée qui en est la cause.
Une fois identifiée apprenez à la mettre en perspective. Effectuez un zoom arrière et demandez-vous combien d’autres personnes ont été rejetées pour ce travail que vous vouliez ? Est-ce juste un poste difficile à décrocher?
Faites de votre mieux pour voir l’autre côté aussi. Je sais cela demande un effort, mais cela vaut le coup d’essayer, c’est tellement puissant!
Lorsque vous vous sentez rejeté, demandez-vous : quels sont les faits qui démontrent la véracité de la pensée par rapport à l’échec
Ne prenez pas le rejet personnellement.
Si vous voulez obtenir un emploi dans l’industrie, vous devez apprendre à vous détacher du résultat.
Ne pas recevoir de réponse n’est pas une attaque personnelle.
Ce n’est pas parce qu’une entreprise dit « non » aujourd’hui que c’est un « non » pour tous les postes futurs, pour toujours.
Chaque rejet est une expérience d’apprentissage. Ne tombez pas dans le piège de vous attarder sur un rejet et de vous demander ce qu’il aurait pu être. Tirez une leçon de l’expérience, prenez de nouvelles mesures et avancez.
Sachez qu’un refus lors d’un entretien ne signifie pas toujours qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Cela dépend parfois de l’intervieweur et des questions posées.
Informez-vous sur le monde de l’emploi
Dans le meilleur des cas, la recherche d’un emploi est une véritable montagne russe émotionnelle, faite de hauts et de bas (même si vous décidez de changer d’emploi).
Si vous avez été contraint de quitter le milieu académique, c’est encore plus stressant.
Si le stress est bien réel, vous pouvez le surmonter. Avoir en main des données factuelles sur la recherche d’emploi, vous aidera à faire baisser du stress généré par votre ignorance.
Par exemple, lorsque vous savez que le ratio moyen entre nombres de candidatures et le nombre d’entretiens est d’environ 20 %, vous n’êtes pas trop déçu si votre téléphone ne sonne pas.
Ou encore, si vous acceptez que la probabilité de décrocher un poste après un deuxième entretien est de l’ordre de 25 % à 50 %, vous ne vous sentirez pas anéanti si vous êtes finalement rejeté.
Il ne s’agit pas d’être pessimiste, mais plutôt d’être réaliste sur la base des données relatives aux demandeurs d’emploi.
Connaitre les données sur le marché du travail et le processus de recrutement, vous permet d’avoir une vision plus équilibrée, ce qui signifie que la logique peut tempérer les émotions au cours du processus de recherche.
Si vous obtenez plus de résultats que la moyenne des demandeurs d’emploi, c’est fantastique. En fait, vous pouvez considérablement faire pencher la balance en votre faveur en faisant jouer votre réseau (voir ci-dessous). Mais le rejet fait partie intégrante du processus de recherche d’emploi (tout comme l’erreur fait partie de l’essai), alors anticipez-le et ne le prenez pas personnellement.

Vérifiez que vos attentes sont raisonnables.
Les vagues émotionnelles (haut et bas successifs) font partie de tout processus de changement.
Les attentes rendent ces vagues beaucoup plus importantes car elles vous amènent à vous investir émotionnellement dans un résultat (par exemple, si vous estimez qu’un certain poste est « le bon » dans votre esprit, mais qu’il ne se concrétise pas, vous êtes anéanti).
Appréhendez chaque interview avec curiosité et intérêt, surtout évitez de vous imaginer déjà dans les locaux de l’entreprise ou d’imaginer tout ce que vous allez vous offrir avec le salaire si vous décrochez le job. Cela ne fera qu’augmenter l’investissement émotionnel que vous mettez dans cet emploi.
Au contraire, pensez plutôt aux avantages et inconvénients du poste, cela vous aidera à voir l’opportunité d’un point de vue plus équilibré plutôt que « le poste idéal », ce qui peut en fin de compte atténuer la déception.
Cela peut également vous aider à éviter une mauvaise décision. Les émotions sont très puissantes et peuvent l’emporter sur notre logique lorsque nous faisons des choix (tous ceux qui sont sortis avec quelqu’un peuvent en témoigner).
Prenez vos responsabilités (mais seulement pour votre part).
Il est très facile de se présenter comme une victime pendant le processus de recherche d’emploi.
Le recruteur a une « dent » contre doctorants
Oui c’est surement à cause de mon prénom « étranger »
C’est couru d’avance, ils voulaient un candidat masculin, je suis tombé sur un macho
J’ai un doctorat, je suis super qualifié, mais pourquoi les employeurs ne frappent-ils pas à ma porte ?
Évitez de jouer la victime et de blâmer les autres pour vos échecs. Cultivez la responsabilité de soi.
Par ailleurs si vous ne décrocher pas d’entretien, c’est peut-être que votre stratégie de recherche d’emploi n’est pas la bonne. Si vous vous contentez par exemple à postuler en ligne, alors en effet vous aurez du mail à décrocher une interview.
Demandez un feedback après un rejet et gardez contact.
Recevoir des critiques constructives n’est jamais facile.
Mais si vous voulez vous améliorer et progresser, c’est absolument nécessaire.
En cas de rejet, n’abandonnez pas et ne coupez pas les liens avec l’entreprise.
Au lieu de cela, renouez avec votre interlocuteur. Restez en contact.
Cela leur montre que vous avez le courage et l’intelligence émotionnelle nécessaires pour travailler dans une industrie difficile.
Cela vous permet également de rester informé des nouvelles ouvertures dans cette entreprise, ou dans l’industrie en général, plus rapidement que vous ne le feriez autrement.
Faites-vous aider
Parfois, nous avons besoin d’une aide plus importante que celle que peuvent nous offrir nos amis, notre famille. L’être humain est complexe, la recherche d’un emploi est source d’anxiété et la vie nous lance rarement un défi à la fois.
Si d’autres problèmes de vie viennent compliquer votre recherche d’emploi ou si vous avez vécu une transition particulièrement traumatisante, alors vous pourriez envisager de vous faire aider soit par un thérapeute ou un coach informé sur les traumas, cela vous aidera à mieux gérer ces difficultés.
Apprenez à faire « pause ».
Tout le monde a besoin d’une pause, même les docteurs !
Il est très facile de s’épuiser lors d’une recherche d’emploi. Passer sa journée collé à l’ordinateur, ne fait qu’alimenter votre frustration lorsque vous ne recevez rien de positif en retour.
Si vous voulez rester motivé, vous devez vous laisser le temps de récupérer.
Faire une « pause » pour prendre soin de soi est indispensable. Les émotions laissent des traces dans le corps et si vous le négligez, alors vous risquez de faire une dépression.
N’hésitez pas à prendre une journée pour vous. Cela vous permettra de prendre du recul. Vous serez plus fort et plus créatif qu’avant.
Des études montrent que quelques jours de congé quand on est en recherche d’emploi, atténue la frustration, change la perspective et suscite la nouveauté.
Les baisses de motivation sont normales.
La seule façon de les surmonter est de trouver un équilibre intelligent entre la recherche d’emploi et le repos.
Conclusion
La recherche d’emploi est un processus intimidant et parfois vécu comme un parcours du combattant. Comme pour tout changement majeur dans la vie, vous aurez à traverser des étapes complexes sur le chemin avant d’atteindre la destination.
Plus vous vous préparez aux divers rebondissements, plus vous aurez de chances de réussir, et peut-être même d’apprécier le voyage.
Cependant pour certains doctorants, la douleur du rejet est une véritable ecchymose émotionnelle. Cela peut saper leur confiance et leur estime de soi.
Si vous êtes dans ce cas et que vous avez du mal à rebondir, vous aurez peut-être besoin de temps pour développer votre sens de l’amour de soi et de l’estime de soi.
Si vous avez aimé cet article, merci de me laisser un commentaire, cela me fera plaisir et m’encouragera à vous partager plus de contenu☺